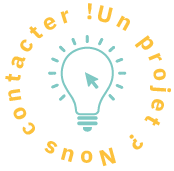Lire aussi :
Comment renforcer l’accès aux opportunités pour soutenir l’engagement ?
Mohamed manage une équipe de 10 personnes chez un équipementier industriel. La fusion annoncée entre deux filiales se met enfin en place, amenant sur le papier une diversification de l’activité et une multiplication des projets pour l’équipe. Pourtant, Mohamed constate que ses collaborateurs, bien que très occupés, semblent moins investis et expriment un certain désenchantement. Certains disent ne pas voir de perspectives d’évolution, d’autres trouvent leur travail plus routinier malgré la complexité technique des dossiers, et plusieurs se sentent cantonnés à leur périmètre habituel. Le sentiment général est à la désillusion, car les missions et évolutions espérées ne sont finalement pas au rendez-vous. Mohamed s’interroge : comment redynamiser l’engagement de chacun·e ?
Les individus engagés au travail s’investissent physiquement, mentalement et émotionnellement dans leur rôle. Cet état d’esprit positif et épanouissant est dépendant de la présence de certains leviers de motivation tels que le sentiment de développement de soi, le sentiment d’effort équilibré et le sentiment d’efficacité personnelle (voir notre article l’engagement au travail : un problème de motivation ?).
Mohamed peut travailler à renforcer l’accès aux opportunités pour chaque membre de son équipe, et ainsi agir sur ces 3 sentiments de la motivation.
1. Accéder à des opportunités renforce le sentiment de contrôle
Le sentiment de contrôle correspond à la conviction de pouvoir agir sur son environnement et d’avoir une influence réelle sur le déroulement des choses. Il joue un rôle fondamental dans la motivation au travail, notamment lorsque les décisions ou les objectifs viennent de niveaux hiérarchiques éloignés (voir notre article sur le sentiment de contrôle).
Pour renforcer ce pilier, Mohamed peut impliquer chaque membre de l’équipe dans l’identification de ses aspirations. Il peut par exemple organiser des entretiens individuels autour des envies d’évolution, des compétences à acquérir, des missions nouvelles à expérimenter, en plus des échanges réguliers sur l’opérationnel et des entretiens professionnels annuels ou bi-annuels.
À partir de ces appétences exprimées, il peut déléguer ou redistribuer progressivement des tâches ou des projets au sein de l’équipe.
Mais la charge de cette adaptation ne doit pas être portée sur ses seules épaules. Il est nécessaire de co-construire avec chacun.e un plan de parcours, en précisant les jalons (missions concernées, expertises à développer, responsabilités temporaires ou missions transverses auxquelles participer) et les ressources disponibles au sein de l’équipe ou de l’entreprise, quitte à inclure les ressources humaines.
Si Mohamed implique véritablement les membres de l’équipe dans la conception de leur trajectoire, il les aidera à se sentir maîtres de leur destinée professionnelle et à croire que l’entreprise leur ouvre des portes, et pas seulement pour les “meilleurs profils”.
Lire aussi :
2. Accéder à des opportunités nourrit le sentiment de développement de soi
Le sentiment de développement de soi correspond à cette impression d’évoluer, d’apprendre, de relever de nouveaux défis et de progresser dans ses capacités. Il s’agit d’un des piliers de l’engagement professionnel (voir notre article sur le sentiment de développement de soi).
Mohamed peut en complément proposer à chacun.e d’acceder à des missions inédites, à des expérimentations ponctuelles ou participer à des groupes projets en dehors de l’équipe. Ainsi il peut créer un environnement qui stimule la progression et l’apprentissage continu.
Une autre piste pour Mohamed est de valoriser la mobilité interne temporaire ou partielle, le « job shadowing » (observation d’un collègue d’un autre service), voire la constitution de binômes hybrides sur des temps courts, accélère les apprentissages “sur le tas”. D’autant plus que le contexte de fusion nécessite l’harmonisation des pratiques, si possible en s’inspirant des forces de chacune des entités d’origine.
À travers ces dispositifs, il peut encourager l’équipe à sortir du cadre habituel – et pas seulement à travers des formations classiques, et créée le terreau de compétences élargies, d’une vision plus transversale et de la confiance dans ses capacités à évoluer. Ainsi, chacun.e peut percevoir qu’il “avance dans sa carrière”, qu’il s’ouvre à de nouveaux domaines, qu’il ne stagne pas mais construit une trajectoire unique au sein de l’organisation.
3. Accéder à des opportunités équilibre l’effort consenti
Le sentiment d’effort équilibré correspond à une balance “effort/bénéfices” liée au travail perçue comme avantageuse. Certes nous attribuons une grande valeur aux résultats issus d’efforts importants, mais dans notre quotidien de travail, percevoir au contraire qu’atteindre certains objectifs nous coûte trop (lenteur, fatigue, déséquilibre pro/perso) peut nous démotiver (voir notre article sur le sentiment d’effort équilibré).
Dans ce contexte de mutation, Mohamed doit dans le même temps veiller à ce que les nouvelles missions ou responsabilités soient adaptées aux envies, au rythme d’apprentissage et à la capacité de chacun.e, pour éviter surcharge et frustration (versus confier uniquement les projets challengeants à ceux qui sont déjà les plus “visibles”).
En offrant des opportunités à la carte, en dialoguant sur ce qui motive réellement chacun.e, Mohamed permet de rendre l’effort consenti pour changer ou évoluer plus pertinent et acceptable : chacun comprend pourquoi il fournit cet effort supplémentaire et ce qu’il peut en retirer.
Enfin, Mohamed peut s’assurer que chaque membre de l’équipe bénéficie, dans la durée, de perspectives réelles, pour que l’effort d’investissement soit reconnu et ne se transforme pas en lassitude. Ceci donne à chacun la conviction que l’entreprise se soucie de son développement, et que les efforts engagés sont justement récompensés.
CONCLUSION
Pour répondre au désengagement lié au manque de perspectives, Mohamed peut miser sur l’accès équitable, personnalisé et réfléchi à des opportunités professionnelles concrètes. En accompagnant chaque membre de son équipe dans l’identification, l’accès et le suivi de missions nouvelles – que ce soit par la mobilité fonctionnelle, la participation à des projets transverses, la prise de responsabilités temporaires ou des parcours individualisés – il nourrit leur sentiment de contrôle, leur développement de soi et veille à un effort équilibré.
L’engagement se revitalise quand chacun perçoit que l’entreprise croit en ses capacités, lui fait confiance pour relever de nouveaux défis et le soutient dans l’exploration de nouveaux horizons professionnels. Le rôle du manager ici est double : ouvrir l’accès à de vraies occasions d’évoluer, tout en accompagnant chacun dans un parcours adapté. Ce levier est à la fois un moteur d’engagement durable… et la clé de la rétention des talents !