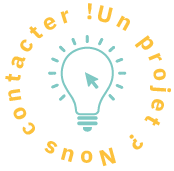En quête de performances, nous cherchons à augmenter notre efficacité individuelle ainsi que la productivité collective. Pour y parvenir, la tentation est forte d’accroître le temps de travail effectif. Mais l’idée qu’un individu puisse démontrer une performance constante du matin jusqu’au soir est un leurre.
Ce que nous apprend le taylorisme : travailler moins pour produire plus
En prenant en compte les limites du corps, le taylorisme a rationalisé l’approche de la productivité. Grâce à des temps de repos au cours de la journée de travail, la cadence pouvait être augmentée et la productivité favorisée. Travailler moins pour produire plus. Ou plutôt travailler selon des rythmes plus optimaux, en consacrant environ 5% du temps aux pauses, pour de meilleures performances. Dans une société désormais orientée vers le service, le travail plus cognitif, accéléré par le numérique et le flux continu d’informations, pose la question des limites du cerveau. Peut-on vraiment suivre ce rythme effréné qui s’impose à nous ?
Faire des pauses, un enjeu majeur
La mobilisation de nos ressources mentales induit de la fatigue : une incapacité temporaire à atteindre ou maintenir une performance cognitive maximale à la suite d’une activité mentale prolongée. Liée à une modification de l’activité de notre cortex préfrontal (la « tour de contrôle » de notre cerveau), ce phénomène a des conséquences importantes – problèmes de concentration, mais aussi orientation inconsciente de nos choix vers des gains immédiats plutôt que de long terme. Après plusieurs heures d’activité mentale, nous sommes plus impulsif·ve·s dans nos décisions et moins performant·e·s dans nos tâches. Réintroduire dans notre quotidien des temps de pauses durant lesquels nous mobilisons des ressources mentales très différentes, devient donc un enjeu majeur.
Mais au-delà des temps de pause, il est également central de questionner les temps de travail et de récupération. Aujourd’hui, la promesse idéale d’une flexibilité du travail qui voudrait que nous travaillions chacun·e à son rythme, quand on veut et où on veut, se traduit par une activité professionnelle omniprésente au sein de nos vies. La disparition des limites pro-perso malmène notre capacité à nous détacher du travail, un ingrédient essentiel à la récupération physiologique. Durant le travail, nous entrons naturellement dans un état d’activation physiologique pour répondre aux challenges de nos missions quotidiennes. Lorsque le temps accumulé dans cet état d’activation n’est pas compensé par un temps de repos suffisant, des répercutions chroniques peuvent survenir, tel un risque accru de tensions musculaires, de fatigue chronique, de maladies cardio-vasculaire et de troubles du sommeil. La santé des collaborateur·rice·s s’en trouve affectée et le maintien des performances n’est plus garanti.
Il est urgent d’adapter nos rythmes de travail aux rythmes de notre cerveau. Et cette adaptation est la responsabilité de l’entreprise. Les rythmes excessifs provoqués par le télétravail, et les difficultés de rétention dans de nombreuses entreprises, doivent inviter chacun·e à mettre ce sujet au centre de la table. A contrario de ce mouvement, le possible report de l’âge de la retraite semble encore une fois résumer la productivité d’une entreprise, et d’un pays, au temps de travail. Mais de l’autre côté, des initiatives comme la semaine de quatre jours viennent questionner un modèle pourtant fortement enraciné dans notre société – travailler plus pour produire plus – et qui n’est certainement plus adapté à l’ère du travail cognitif.